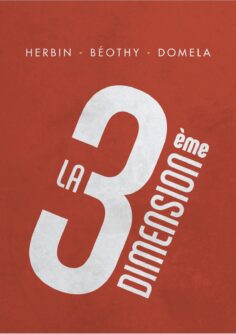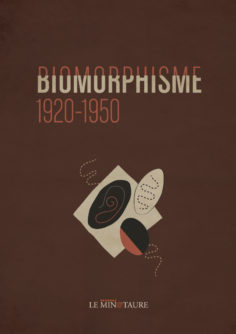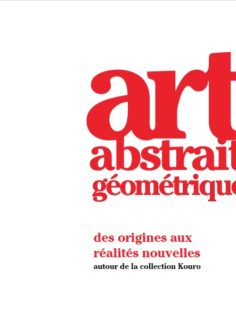Né en 1882 à Quievy, près de la frontière belge, Auguste Herbin étudie à l’École des Beaux-Arts de Lille avant de s’installer à Paris en 1901. Il débute par l’impressionnisme, parcourt le fauvisme puis, au contact de Braque et Picasso rencontrés en 1909 au Bateau Lavoir, se rapproche progressivement du cubisme. Autant d’expériences qui le mèneront in fine àl’abstraction géométrique.
Rapidement ses œuvres rencontrent le succès : elles sont achetées par les plus grands collectionneurs de l’époque – Léonce Rosenberg, Wilhelm Uhde, Hendricus P.Bremmer, Hélène Kröller-Müller, Alfred Flechtheim et Serge Chtchoukine – et exposées même à l’étranger: à Cologne au Sonderbund (1912), à Berlin à la Secession et à Der Sturm (1912), à New-York à l’Armory Show (1915).
Si la Première Guerre Mondiale est une période peu productive pour Herbin, elle est l’occasion de se consacrer à des recherches plus personnelles. Sous les conseils de Léonce Rosenberg avec qui il collabore depuis 1916 – ses œuvres sont exposées à plusieurs reprises à la Galerie de l’Effort Moderne –, le peintre s’engage dans une usine d’aéronautique où il est chargé de peindre les camouflages d’avion. Cette activité lui permet avant tout d’échapper au front mais également d’expérimenter, via le support inédit de l’avion, un nouveau langage de l’abstraction et de la géométrie. À partir de 1917, il trouve alors le temps de formuler, cette fois-ci sur la toile, les possibilités plastiques mûries à l’arrière : il peint une quinzaine de compositions et de nombreuses études cubistes synthétiques dans lesquelles la dualité entre la forme et le fond est abolie. Son cubisme insiste sur des structures très architecturées, composées de plans superposés avec des éléments stylisés, des formes géométriques simplifiées. En 1918, ses compositions sont toutes quasiment abstraites.
De cet abandon progressif du cubisme découle une série d’objets nouveaux : les « objets monumentaux » (1919-1921). Pour le peintre, ces œuvres « monumentales » – fresques, reliefs, sculptures – réalisent un art total, conforme à ses convictions politiques (il est membre du Parti communiste depuis sa création en 1920 et affiche très tôt sa sympathie envers les idées internationalistes). Malgré leur caractère novateur, ces objets ne rencontreront pas un accueil favorable auprès de la critique et ouvriront la voie à une nouvelle période d’hésitation, marquée par des va-et-vient entre abstraction et figuration.
Ce n’est réellement qu’à partir de 1927 que Herbin décide de rejeter définitivement la peinture figurative. Il se met alors à développer activement sa peinture abstraite en y mêlant la rigueur des formes géométriques au jeu des formes courbes. Parallèlement, il participe à la création de divers salons et associations rassemblant des personnalités importantes du champ artistique. En 1929 il prend part à la fondation du Salon des Sur-indépendants et deux ans plus tard, en 1931, à celle du groupe Abstraction Création. Après la Seconde Guerre mondiale, il sera l’un des principaux animateurs du Salon des Réalités Nouvelles.
Dans les années 1940, le peintre élabore son « alphabet plastique », une méthode de composition rigoureuse qui deviendra la clé de sa création future et dont il exposera les fondements dans L’Art non figuratif, non objectif (1949). Influencé par la théosophie de Rudolf Steiner et la théorie des couleurs de Goethe, il met au point un système qui fait correspondre chaque lettre de l’alphabet à une couleur, une ou plusieurs formes géométriques et une note de musique. Ses peintures s’agencent alors selon une logique spécifique, à partir d’un mot donnant son titre au tableau.
Il meurt en 1960 à Paris, laissant une œuvre qui aura une grande influence sur l’art abstrait et l’art cinétique de l’après-guerre.